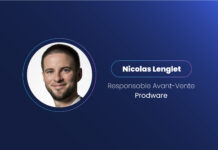Innovation et écologie semblent à priori bien éloignées l’une de l’autre : d’un côté l’industrie, de l’autre la nature. Pourtant, il est peu judicieux d’opposer écologie et innovation, car ces deux dimensions peuvent se renforcer mutuellement. Il est grandement souhaitable d’adopter une vision élargie de l’innovation : une conception capable d’intégrer aux côtés de la technologie la dimension humaine et celle du vivant – une conception « écologique » de l’innovation.
« La difficulté ne réside pas tant dans le fait de développer de nouvelles idées que d’échapper aux anciennes », disait Keynes. Nous devrions tous avoir cette phrase en tête pour comprendre que l’attachement à l’état actuel des choses – quel qu’il soit – est plus que tout ce qui freine la possibilité d’innover. Il est plus facile de trouver de nouvelles idées que de se déprendre des anciennes, et plus précisément : il est plus facile de trouver de nouvelles idées lorsque l’on parvient à se déprendre des anciennes.
Si l’on doit se déprendre des idées anciennes, c’est bien parce qu’elles nous enferment dans une façon de voir qui vise à ne pas être changée. Les idées anciennes forment toujours un système cohérent dont les éléments se soutiennent et se renforcent les uns les autres, et pour cela sont résistants au changement. Ce qu’il nomme « idées anciennes » désigne pour Keynes les idées « qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit des personnes ayant reçu la même formation que la plupart d’entre nous ». « Idées anciennes » nomme en fait ce sur quoi un grand nombre de personnes s’entend : autrement dit, le consensus propre à une période historique. Les idées anciennes sont donc celles qui règnent dans le présent d’une époque, faisant consensus. De ce point de vue, l’ancien, c’est toujours le présent – ce qui est inexorablement condamné à être dépassé par l’évolution, que ce soit dans le sens du progrès ou de la régression. Pendant longtemps, la certitude que la terre était au centre de l’univers faisait système avec l’ensemble des croyances et du savoir d’une époque. Ceux qui ont remis en question un tel édifice culturel pour promouvoir l’héliocentrisme (Copernic, Bruno, Kepler ou Galilée) l’ont fait au risque du bannissement, de la censure et même, parfois, de leur vie.
L’innovation met en question des idées, ou un système de pensée, une conception du monde, dont il est toujours difficile de se défaire. C’est pour cette raison qu’elle est bien souvent contre-intuitive.
Tenter un rapprochement entre « écologie » d’un côté et « innovation » de l’autre peut se heurter à ce genre de difficulté où l’attachement aux certitudes faisant consensus d’un champ de réflexion – ou à celles qui relèvent d’opinions dénuées de tout fondement scientifique – peut bloquer l’apparition d’idées nouvelles, c’est-à-dire le changement. Les deux termes semblent appartenir à des registres plus ou moins compatibles. En effet, l’écologie renvoie à l’idée d’un ordre naturel où l’écosystème est formé par les relations ou interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L’idée d’innovation renvoie plus évidemment à la science et à la technoscience, c’est-à-dire à la dimension technologique du progrès. Du côté de l’écologie, comme de celui de la technologie, la résistance aux changements de perspective, comme partout, peut se révéler très forte – surtout lorsque l’on est persuadé d’avoir raison ou de détenir la vérité.
Pourtant, la situation écologique contemporaine liée au réchauffement/dérèglement climatique oblige à un changement. Changement global, changement de cadre de pensée, changement de méthodes, changement des rapports inter-espèces, changement des rapports aux écosystèmes, etc. Et changement signifie idées nouvelles, donc émancipation des anciennes. Il est alors peut-être intéressant de se demander ce que l’innovation aurait à voir avec les équilibres naturels, et comment l’écologie pourrait être aidée par l’innovation …
Deux impasses : le retour en arrière et la fuite en avant
Poser côte-à-côte les deux mots « écologie » et « innovation » conduit immédiatement à penser à la crise écologique, au réchauffement climatique, et aux conséquences des activités humaines sur les équilibres planétaires. L’innovation, et l’industrie qu’elle a notamment rendue possible, vague après vague, seraient responsables en partie de ces multiples déséquilibres.
Face à cette considération pouvant difficilement être éludée aujourd’hui, deux positions dominantes sont en présence : le retour en arrière et la fuite en avant. Selon ses partisans, un retour en arrière serait l’unique voie pour juguler le désastre écologique et les nombreuses atteintes au climat par un renoncement général aux modes de vie modernes. Il s’agirait ainsi en quelque sorte de « désinnover ». Du côté de la fuite en avant, les tenants d’une solution toute technologique à la crise écologique soutiennent que la logique qui a causé les dommages peut tout aussi bien en venir à bout, et inverser de néfastes conséquences. La géo-ingénierie, ce secteur de la recherche qui désigne l’ensemble des techniques envisagées pour modifier le climat à grande échelle, serait la solution. Elle pourrait résoudre à l’aide d’élaborations technologiques de grande ampleur tous les problèmes liés au réchauffement/dérèglement climatique. L’ingénierie climatique regorge de projets, soutenus par des laboratoires, des entreprises ou des milliardaires : boucliers chimiques (particules de souffre) vaporisés dans l’atmosphère contre le rayonnement solaire, fertilisation des océans pour produire des algues stockeuses de CO2, envoi de gigantesques écrans pare-soleil dans l’espace, peinture en blanc des surfaces urbaines pour augmenter l’albédo, voire modification de l’axe de la Terre. Personne, y compris les promoteurs de ces projets à dimension planétaire qui tous visent à intervenir au niveau du fonctionnement fondamental de la Terre, n’est aujourd’hui vraiment capable de mesurer les conséquences écologiques de ces solutions. La question se pose alors : « et si le remède était pire que le mal ? ».
Ces deux attitudes diamétralement opposées se ressemblent au fond dans leur difficulté à couvrir tout l’éventail des problèmes à résoudre. En effet, leur approche partielle peine à prendre la mesure des enjeux en question, même si elles ont le mérite de proposer des solutions, étant entendu que l’on ne peut pas rester dans l’état du présent, et que l’on doit impérativement et rapidement changer de perspective. Par ailleurs, ces deux axes de réflexion ne semblent pas en mesure de dialoguer sereinement tant leurs points de vue partent de prémisses qui s’opposent : la nature devrait être plus ou moins laissée à elle-même (il conviendrait donc d’exclure ou de minorer toute approche basée sur la technologie) pour les premiers, la technologie serait toute puissante et devrait par conséquent s’imposer à la nature, y compris pour réparer les dommages qu’elle-même a pu causer, pour les seconds.
La nature, la plus grande innovatrice
Pourtant, il est peu judicieux d’opposer écologie et innovation. En fait, le modèle absolu de l’innovation, c’est l’objet même de l’écologie : la nature. Celle-ci est la plus grande pourvoyeuse d’innovation jamais vue. Certes, la nature ne crée pas de startups, mais elle innove de façon continue. Ses innovations sont multiples et incessantes : elle n’arrête pas de créer de nouvelles espèces, de les faire évoluer, de générer des mutations, de produire de la vie. Par exemple, les arbres qui repoussent sur des terrains ayant connu des incendies croissent avec une écorce différente qui les protège davantage contre d’intenses chaleurs, comme s’ils avaient appris et su innover pour mieux se défendre d’un danger inédit. Mais, comme ces productions sont naturelles, elles nous apparaissent comme « naturelles » : plus personne ne s’émerveille de leur existence et de leur complexité. Pourtant, la création quotidienne de milliards de cellules est-elle moins « innovante » qu’une innovation ayant transformé une entreprise en licorne ? Et même ce que nous appelons « innovation » est relié à cette capacité de la nature à innover, qui a donné à Homo Sapiens cette aptitude inédite à inventer et à créer des outils de plus en plus sophistiqués, jusqu’à ce que les êtres humains puissent se croire « comme maitres et possesseurs de la nature », ainsi que le prophétisait Descartes au 17ème siècle.
C’est donc de la nature elle-même, et de ses qualités holistiques régies par l’interaction, dont il serait souhaitable de s’inspirer pour commencer à progresser dans le règlement de cette question. Une vision holistique est celle qui ne s’arrête pas aux frontières convenues, mais parvient à les dépasser pour penser en termes d’interaction et d’interrelation.
Le biomimétisme est, par exemple, une option d’innovation qui s’inscrit dans cette perspective où l’imitation de la nature, de ses procédés comme de ses résultats, permet la fabrique industrielle d’artefacts dotés de caractéristiques spécifiques répondant précisément à un besoin. Cette approche conçoit la nature et l’évolution comme un service R&D d’une grande efficacité qui garantit, par la qualité d’une matière ou la parfaite fonctionnalité d’une forme, l’efficacité d’un « produit » testé et amélioré parfois pendant des millénaires. Cette approche permet également d’envisager des productions humaines travaillant en symbiose avec les équilibres qui régulent la biosphère. Leur résultat pourrait résoudre l’un des principaux casse-têtes auxquels s’affronte la modernité : rendre compatible innovation industrielle et protection de la nature. Ainsi, une symbiose industrielle avec la nature serait capable de restituer au progrès toute sa dynamique positive.
Innover écologiquement
Il est donc grandement souhaitable d’adopter une conception de l’innovation qui ne se réduise pas à la seule dimension technologique qui, bien qu’elle soit indispensable, n’est pas suffisante ; une conception élargie capable d’intégrer aux côtés de la technologie la dimension humaine et celle du vivant – une conception « écologique » de l’innovation, si l’on peut dire. Cela est cohérent avec la nécessité d’une innovation qui prenne en compte un progrès fondé sur l’idée de bien commun. Et ce dernier n’est pas la seule affaire de l’espèce humaine, mais doit intégrer les écosystèmes et les autres espèces : pas de bien commun sans l’idée d’un monde commun où cohabitent toutes les modalités du vivant. Et du côté de l’écologie, comprendre que ce terme ne renvoie pas seulement au biotope. Il faut aussi considérer une écologie des relations humaines, une écologie du travail, par exemple.
Il faut donc plus que jamais développer et soutenir une vision humaniste de l’innovation : avant d’innover technologiquement, on doit innover dans nos pensées et nos façons d’agir. L’innovation, c’est être dans un état d’esprit différent, qui va permettre à chacun d’accepter une part de nouveauté dans ses comportements, notamment dans sa consommation. Innovation et écologie, c’est avant tout innover « dans sa tête ». C’est accepter des règles du jeu différentes où l’utopie trouve la voie d’une réconciliation avec un réalisme plus que jamais nécessaire. Ce n’est d’ailleurs qu’en innovant dans nos pensées, hors de tout dogmatisme, que l’on innove : l’innovation technologique ou le dispositif innovant ne sont finalement qu’une concrétisation d’une innovation de pensée. Une fois cette dernière réalisée, une fois ce nouveau cadre mental établi, l’innovation technologique peut alors intervenir en tant qu’outil, pour mieux répondre avec toute sa capacité à transformer les choses. C’est là que les défenseurs d’une vision strictement technophile ou ceux qui ne voient l’innovation qu’à travers le prisme de la technologie peuvent être mis à contribution. La technologie permet de cette manière d’intervenir vite et de façon efficace sur des objectifs sur lesquels tout le monde s’est mis d’accord en fonction d’un cadre de pensée différent.
Chacun essaie bien sûr d’avoir une meilleure Terre. Mais qui met vraiment les moyens au service de ce projet ? L’enjeu est avant tout une prise de conscience de l’urgence climatique. Dans ce qui est à notre portée, qu’est-ce qui peut faire consensus ? Quel pacte est-on prêts à signer pour que la nature retrouve ses droits ?
Des choix (toujours difficiles) sont à opérer dans les combats à mener, en sachant qu’on ne peut les mener tous de front. Proposons ici une nouvelle articulation entre concept et action : plutôt que de saupoudrer inefficacement des essais de solutions, pourquoi ne pas identifier deux ou trois grands problèmes sur lesquels, soutenue par une pensée au service de projets, la technologie issue de plusieurs pays et de plusieurs acteurs industriels pourrait concentrer ses efforts ? Puis, faire porter tout l’engagement au niveau d’une ville, d’une région, d’un pays, d’un continent. Dans cette approche qui consisterait à choisir quelques chantiers prioritaires sur lesquels focaliser toute l’attention, on pourrait établir de grands programmes, par exemple à l’occasion des COP. Cette concentration qui réclamerait d’énormes moyens, aussi bien en recherche qu’en mise en œuvre, serait ainsi mutualisée, et contribuerait à créer des faisceaux industriels internationaux, des alliances économiques nouvelles créatrices de valeur tout en luttant contre la crise climatique. Ici, la technologie est à l’évidence un accélérateur majeur du règlement de ces problèmes. La dimension financière est évidemment au cœur de l’équation car, sans elle, rien ne peut se faire, même si on dispose des meilleures technologies.
La résolution du problème n’est la chasse gardée d’aucun parti politique, ni celle d’une école ou d’une tendance. Les technophiles pas plus que les adversaires de l’industrie ne peuvent prétendre avoir le monopole des solutions pour endiguer la crise climatique, et générer un modèle de développement plus respectueux des grands équilibres. Et l’État ou le politique sont loin d’être les seuls à pouvoir aider à résoudre le problème. Quelle que soit sa sensibilité, on doit tous se demander ce qu’il convient de faire, individuellement aussi bien que collectivement, face aux grands enjeux mis à jour par la crise climatique. Quel effort est-on capable de produire et de supporter pour préserver la planète ? La crise climatique oblige (ou obligera) de gré ou de force à repenser les modalités de nos modes de croissance économique et de consommation.
De toutes façons, nous sommes condamnés à innover, car – pour finir cette chronique comme nous l’avons commencée, avec Keynes – « ce qui arrive en fin de compte, ce n’est pas l’inévitable mais l’imprévisible ».
Article initialement paru dans La Tribune.fr